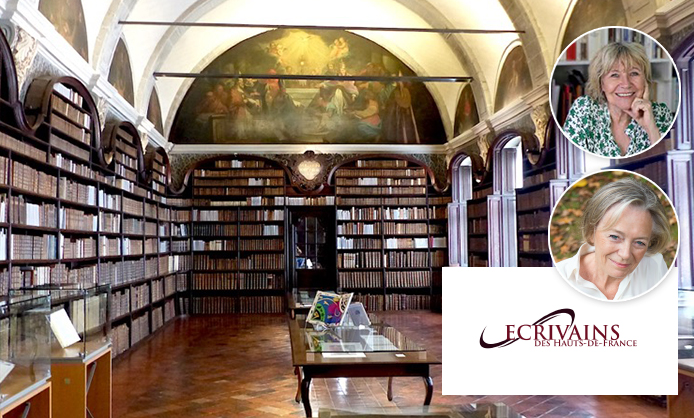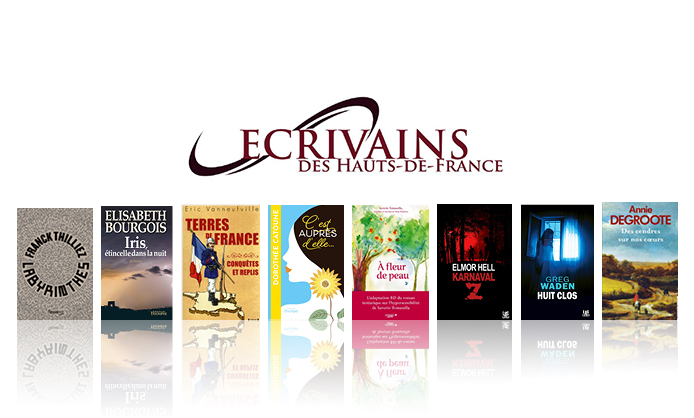« Je revois la maîtresse de maison se lever pour déclamer
quelques vers de sa composition. Brel, dans son coin, n’arrêtait pas de me faire des clins d’œil », s’amuse Devos. Derrière la taquinerie, le maître des mots est sincèrement ému. « Quel plaisir de voir la chambre où j’ai poussé mes premiers vagissements », confie-t-il à Jules Menet. Et les deux hommes de se lancer dans un dialogue surréaliste sur le thème : « Mais, ma maison est la vôtre ! »
Le soir, après dîner, Brel continua à écumer les bistrots du coin, en compagnie du producteur Pierre Celie et de Maurice Deguffroy, un animateur de Radio Lille. Dans ce quartier frontalier du Mont à Leux, ils terminent la nuit au café Adrienne.
Pour les besoins de la rime, Jacques Brel transforma Adrienne Verschivère, la tenancière du Mont à Leux, en « la grosse Adrienne de Montalant. » Celle du bistrot où on allait « boire et brûler nos vingt ans » ! On connaît le refrain de la chanson : « Les Bourgeois, c’est comme… »
Flonflons, kermesses, défilés carnavalesques, courses cyclistes, estaminets où coule la bière, harmonies municipales, majorettes : le plat pays cultive le goût de la fête populaire. « Dans le vélo, il y a deux roues. Il y a un cadre. Le cyclisme est un sport populaire. Il permet à l’ouvrier de rouler sur son cadre », s’amuse Devos. L’humoriste aurait aimé écrire le Paris – Roubaix de 1968. « J’imagine les coureurs harassés, révoltés, qui descendent de vélo, et arrachent les pavés pour les jeter à la tête des spectateurs et des organisateurs. »
Jean STABLINSKI
« Sous les pavés, la plage », scandaient les manifestants. En cette année 1968 justement, le Paris – Roubaix est en plein désarroi. Les pavés disparaissent les uns après les autres. « L’Enfer du Nord » n’est plus qu’une course banale, réglée au sprint l’année précédente par le Néerlandais Jan Janssen. Jacques Goddet, directeur de l’épreuve et patron de l’Équipe, confie à l’ancien coureur cycliste professionnel Albert Bouvet la délicate mission de trouver coûte que coûte de nouveaux secteurs pavés. Bouvet pense immédiatement à son ami, le coureur nordiste Jean Stablinski. Fidèle coéquipier de Jacques Anquetil, champion de France à quatre reprises, vainqueur du Tour d’Espagne, champion du monde en 1962, Stablinski est un forçat de la route, une légende du cyclisme.
Né à Thun-Saint-Amand dans une famille modeste d’émigrés polonais, il quitte tôt l’école pour devenir zingueur, mineur de fond, cimentier. Il connaît par cœur les chemins aux environs de Valenciennes, de Raismes et de Saint-Amand-les-Eaux. Il emmène Albert Bouvet là où il avait travaillé : à la mine d’Arenberg. Et lui fait découvrir la Drève des Boules d’Hérin, un étroit chemin forestier. Le choc est brutal. L’espace de 2,4 km en ligne droite, le Nord y déploie tous ses visages : les chevalements de la mine d’Arenberg, une voie ferrée, le pont minier en surplomb qui emmenait les schistes jusqu’au terril voisin, une voie en pleine nature qui s’enfonce dans la forêt. Au sol, de gros pavés disjoints, non alignés, mal taillés. Peut-on lancer des coureurs cyclistes sur une telle portion pavée ? Les dirigeants hésitent mais finalement prennent le risque. Avec une chevauchée fantastique d’Eddy Merckx, la trouée d’Arenberg devient immédiatement le haut lieu de Paris – Roubaix. Dans l’Équipe, le journaliste Pierre Chany, le premier, parle de « la tranchée d’Arenberg », réminiscence du Paris – Roubaix couru juste après la Grande Guerre dans une région dévastée, baptisée « l’Enfer du Nord ». L’écrivain Philippe Delerm a consacré un ouvrage à la tranchée. « C’est du cyclisme à l’épique, une histoire de guerriers qui rêvent de rentrer dans l’histoire, écrit-il (…) Alors tranchée, mais d’Arenberg : une bouffée de belgitude, où dormiraient des connotations germaniques. Le râpement dans le gosier a des arrière-goûts de bière, de no man’s land guerrier. »
Le Paris – Roubaix 1968 est aussi le dernier de Jean Stablinski qui termina à la 24e place. Avec un humour digne de Raymond Devos, le champion nordiste dira de la trouée d’Arenberg : « Je suis le seul coureur à être passé en dessous et au-dessus. Et c’est moins dur au-dessus. »
Aujourd’hui, les passionnés de vélo viennent du monde entier pour se recueillir sur la stèle de Jean Stablinski qui veille à l’entrée de la « tranchée ». Raymond Devos a donné son nom à une école de Mouscron et au théâtre municipal de Tourcoing. Sa maison à Saint-Rémy-lès-Chevreuse est devenue un musée. La postérité est passée par là.
Comme dit Antoine Blondin, l’écrivain fou de cyclisme… « Le haut du pavé se retrouve toujours sur les pavés du haut. »
Herve LEROY
Extrait du livre « Les Gens du Nord qui ont fait l’Histoire ». Papillon rouge éditeur
Jouez avec les fautes !

Pour Bruno Dewaele, champion du monde d’orthographe, la langue française est un terrain de jeu illimité. Orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire et même typographie, il vous propose dans ces 150 textes soumis aux lecteurs de Télé 7 Jeux de passer en revue quelque 2000 fautes parmi les plus courantes. C’est à vous de repérer ces erreurs cachées dans des textes courts et d’en apprendre un peu plus sur leur bon usage, toujours avec humour et clarté !
Cet ouvrage peut se lire par petits bouts pour dénicher des fautes que nous commettons régulièrement et qui sont assez simples à éviter… grâce à la pédagogie déployée par Bruno Dewaele dans ses corrections.
Bruno Dewaele est professeur agrégé de lettres modernes. Il remporte le titre de
« champion du monde d’orthographe » en 1992 à New York, lors de la dictée de Bernard Pivot. Blogueur, journaliste et chroniqueur, il est l’auteur de nombreux livres sur la langue française.
« Cherchez la faute » de Bruno DEWAELE – 2024 – Ed L’opportun – 320 pages – 16,90 €
Rencontre a Tourcoing, entre un maire anticlérical et un jeune curé
Gustave DRON : médecin et député, puis sénateur-maire de Tourcoing entre 1889 et 1930
Achille LIENART : curé de Saint-Christophe à Tourcoing de 1926 à 1928, évêque de Lille en 1928, cardinal en 1930
‒ Asseyez-vous donc, Monsieur le Curé.
‒ Merci, Monsieur le Maire.Fringant quarantenaire, l’abbé Achille Liénart avait déposé sa bicyclette quelques instants plus tôt devant la façade de l’Hôtel de ville afin de se rendre à l’entrevue de courtoisie sollicitée auprès du très anticlérical Gustave Dron. Tout juste nommé doyen de Saint-Christophe en ce mois de février 1926, il considérait comme normal qu’un nouvel administré, fût-il curé, rende visite au premier magistrat de sa ville. En outre, fin politique, il voyait dans ce contact l’occasion de prévenir d’éventuelles tensions. Dans ce but, rien ne valait, selon lui, l’installation puis l’entretien d’une relation personnelle.
‒ D’où êtes-vous originaire ? interrogea Dron sur un ton aimable.
‒ Je suis né à Lille, répondit Liénart. Mon père était négociant en toile et ma mère a élevé ses trois enfants. J’ai suivi mes études au collège Saint-Joseph où j’ai passé mon baccalauréat de philosophie.
‒ Et depuis ?
‒ Eh bien : le séminaire d’Issy-les-Moulineaux, trois ans de service militaire au 43e RI à la Citadelle de Lille, le séminaire Saint-Sulpice et l’Institut catholique de Paris. J’ai été ordonné prêtre en 1907 et je suis allé me spécialiser en Écritures saintes à l’institut biblique de Rome. Ensuite, enseignement au séminaire de Saint-Saulve. Et puis, la guerre…
‒ Où étiez-vous affecté ?
‒ Je me suis porté volontaire comme aumônier de la 51e division de réserve. Départ pour les Ardennes. Puis la bataille de la Meuse, celle de la Marne, celle de la Somme…Dron observa la ride qui s’était creusée entre les yeux du prêtre.
‒ Blessé ? demanda-t-il sur un ton moins protocolaire.
‒ Deux fois, oui. Mais rien de grave par rapport aux blessés et aux mourants que j’ai essayé d’accompagner jusqu’au bout de cet enfer. Quand je suis rentré, en dix-huit, j’ai enseigné au Grand séminaire de Lille et me suis intéressé de près aux questions sociales. Et me voici à Tour-coing, Monsieur le Maire.
L’homme plut à Dron. Il s’avérait bien différent de ses prédécesseurs. Plus rusé peut-être, se fit-il la réflexion après avoir noté la référence de Liénart aux questions sociales. Celui-ci confirma son intuition.
‒ J’ai eu de nombreux échos de votre action en faveur des plus démunis. De vos réalisations hygiénistes et sociales. L’abbé Lemire ne tarit pas d’éloge à votre égard.
‒ Plus, en tout cas, que les prêtres des paroisses de la ville, répliqua Dron.
‒ Oui je sais bien, Monsieur le Maire. Les péripéties du début du siècle ont laissé des traces. En tout cas, je peux vous assurer de ma volonté d’entretenir des relations de respect mutuel entre ma paroisse et la municipalité.
‒ Tout ira bien si vos paroissiens respectent la Loi républicaine, trancha Dron.
‒ Bien entendu. Et je les inciterai toujours en ce sens. Ne sont-ils pas citoyens comme vous et moi ?
Sur cet échange en demi-teinte, reflet de fortes personnalités se jaugeant mutuellement, les deux hommes se levèrent et se serrèrent la main. Dron y mit un peu plus de chaleur qu’il ne l’avait prévu.
« Gustave Dron – Une statue vivante »
Roman biographique de Jean-François Roussel Les Éditions du Net, 2020